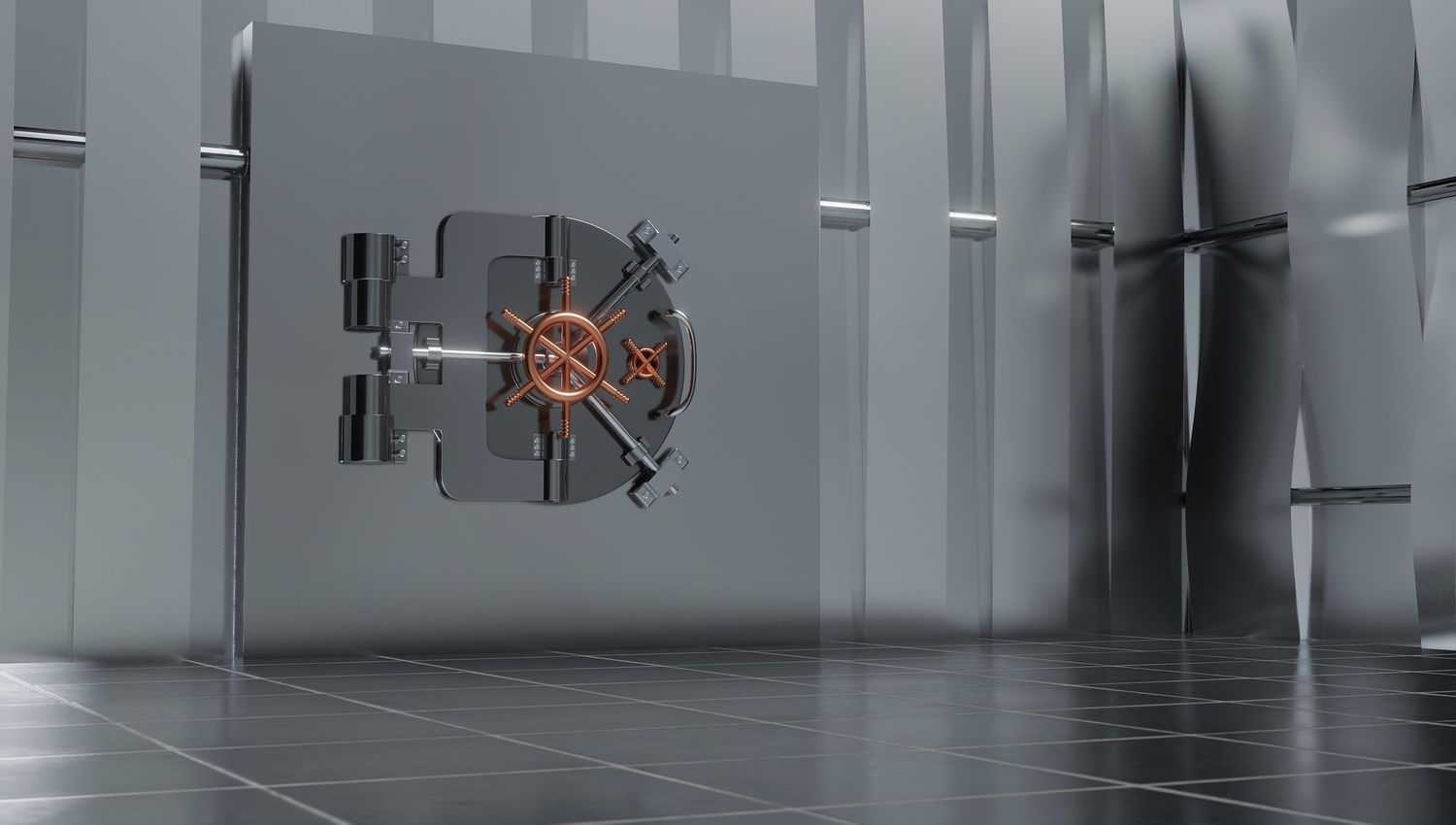La FINMA, accusée de nuire à la compétitivité de la Suisse
Certaines voix dénoncent les exigences toujours plus contraignantes de la part de l’organe de surveillance des marchés.
Parmi les nombreux objectifs de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers figure celui d’améliorer la réputation de la place financière suisse. Mais aussi sa compétitivité. Il semblerait toutefois que ce deuxième point soit de plus en plus souvent remis en question par un nombre croissant d’acteurs de cette même place financière, notamment par les gérants indépendants. Fondateur de la société Dominicé & Co, qui gère le hedge fund Cassiopeia, Michel Dominicé observe un certain durcissement dans la pratique de la Finma depuis 2009. Une tendance, selon lui, qui ne devrait aller qu’en se renforçant avec la révision de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPPC), dont l’entrée en vigueur est prévue au début de l’année prochaine. Il constate que les échanges deviennent plus difficiles avec l’organisation, dont les exigences se font de plus en plus «tatillonnes» pour le moindre changement: «Nous allons plus loin que la plupart de nos homologues européens, regrette Michel Dominicé. Même les avocats spécialisés ont de la peine à anticiper et à comprendre certaines décisions de la Finma.» Les conséquences de ce haut niveau de contrôle étant l’établissement de plusieurs fonds de placement en dehors des frontières suisses, notamment au Luxembourg où les autorités de surveillance se montreraient plus pragmatiques et ouvertes à attirer des affaires et des emplois. La base du problème serait que la Finma ne ferait pas une distinction suffisante entre les différentes catégories d’investisseurs: les qualifiés, c’est-à-dire les professionnels bénéficiant d’un degré de protection suffisant et «sachant ce qu’ils font», et les autres. Cette «hantise» de vouloir protéger plus que nécessaire aurait au final des résultats contre-productifs en termes de sécurité, puisque de nombreux investisseurs préféreraient «investir dans des produits moins protégés, notamment aux Caïmans», que dans des produits sûrs enregistrés en Suisse. Bref, on aurait, selon Michel Dominicé, de plus en plus l’impression que «la Finma n’a pas de vision commerciale pour la Suisse».
Trop pointilleuse
Pour sa part, le directeur de la société de conseils financiers SwissmeFin, Christophe Lamon – dont l’associé Christian Meylan a travaillé comme consultant auprès de MAS, l’organe de régulation financière de Singapour – estime que «le côté pointilleux actuel de la Finma», en rapport avec le passé, ne fait que refléter le changement de paradigme de ces dernières années, à savoir que la Suisse a perdu des aspects essentiels de sa compétitivité qu’étaient «la prévisibilité et l’étanchéité du droit suisse». Cette dernière n’existant plus dans le sens où les banques helvétiques se font attaquer sur leur pré carré par des régulateurs ou des institutions gouvernementales étrangères. Quant à la prévisibilité du droit, elle n’existe plus non plus dans le sens où la classe politique «cède sur des éléments essentiels du droit bancaire helvétique sans pour autant offrir une vision de sortie». Dès lors, pour Christophe Lamon, la position actuelle de l’organisme de contrôle ne fait que refléter cette incertitude face aux lois futures et lui fait adopter une attitude maximaliste: «Constatant que les limites de l’acceptable bougent tous les jours en fonction du rapport de forces politique, la Finma se concentre sur la prévention de nouveaux cas.» Les visions divergentes des partis gouvernementaux face aux politiques de la place financière ne laissent selon lui augurer que peu d’amélioration. Par ailleurs, en comparant l’attitude actuelle de l’organisation avec d’autres régulateurs (tels que MAS à Singapour ou le FSA en Angleterre), les deux associés considèrent que celle-là ne joue ni un rôle de promoteur économique à l’instar du premier ni de «gendarme orienté» de la place financière dans le cas du second. «Le rôle de promoteur en Suisse est échu au Conseil fédéral. Or celui-là ainsi que les chefs de partis gouvernementaux sont bien loin d’un alignement des vues», relève Christophe Lamon, pour qui le comportement de la Finma reflète une minimisation du risque: les bénéfices d’une politique plus risquée seraient crédités au politique, tandis que les revers lui seraient immédiatement imputés. Les reproches n’émanent pas uniquement des petites structures. Les grandes banques, comme Credit Suisse, s’inquiètent aussi du renforcement des mesures visant à accroître la protection des investisseurs et qui exigent des dépenses et des efforts toujours plus importants, notamment en matière de formation. La banque note par exemple qu’il devient de plus en plus difficile pour un conseiller à la clientèle de s’occuper de plus de deux ou trois zones géographiques en raison de l’augmentation des nouvelles exigences de documentation et de l’impossibilité de connaître toutes les réglementations locales en vigueur.
3800 gérants de fortune en Suisse
Pour sa part, la Finma répond à ces critiques en soulignant qu’en ce qui concerne les gérants de fortune ceux-là ne sont soumis en Suisse qu’à une surveillance sous l’angle de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA). Le contrôle se limitant au respect des devoirs de diligence de la loi, comme par exemple le devoir d’identifier ses clients. Ils ne sont soumis pour l’heure à aucune surveillance étatique prudentielle: «Aucun contrôle étatique n’est conduit pour vérifier que les gérants respectent des devoirs de comportement visant la protection des investisseurs», note Tobias Lux, porte-parole de la Finma, en ajoutant qu’aucun contrôle n’est conduit sur leur état financier et qu’il en va de même des sociétés offrant des services fiduciaires (trusts, fondations). La révision de la LPCC ne change rien à cette situation, puisque celle-là n’introduit «aucunement» une surveillance prudentielle des gérants de fortune mais concerne uniquement les gérants de placements collectifs. «Jusqu’à présent, seuls les gérants de fonds suisses étaient soumis à la surveillance de la Finma, poursuit Tobias Lux. La révision de la LPCC a introduit une nouvelle obligation d’assujettissement pour les gérants de fonds étrangers de grande taille, c’est-à-dire à partir d’un seuil de 100 millions.» Il note par ailleurs que les gérants de fonds étrangers concernés ont un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la loi, prévue en février 2013, pour déposer une requête. Des exigences qui ne concernent toutefois ni la gestion de fortune individuelle ni les services fiduciaires. Selon les estimations de l’association, le nombre de gérants de fortune en Suisse s’élève à environ 3800. Quant au nombre de gérants de fonds suisses surveillés par la Finma, il se chiffre à environ une centaine.
Des coûts financés par les établissements
En ce qui concerne la comparaison avec d’autres places financières concurrentes, l’association, qui emploie quelque 350 collaborateurs, en revient à l’absence de surveillance prudentielle des gérants de fortune, une situation qualifiée d’unique en Europe. Tobias Lux relève que la directive européenne concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID) prévoit différentes exigences envers les gérants de fortune visant la protection des investisseurs, notamment en matière de compétences, d’organisation, de règles de comportement ou de fonds propres. Il note par ailleurs que Singapour prévoit elle aussi «des exigences de type prudentiel pour les gérants de fortune». Enfin, en ce qui concerne les coûts, intégralement financés par les établissements surveillés par le biais d’émoluments et de taxes de surveillance, la Finma relève que si les gérants les considèrent élevés ils peuvent s’assujettir auprès de l’un des onze organismes d’autorégulation autorisés par l’organisation. Ceux qui choisissent de s’assujettir directement auprès d’elle doivent s’acquitter d’une taxe de surveillance annuelle, qui varie selon leur capacité financière. A titre d’exemple, la majorité des intermédiaires financiers du secteur parabancaire directement assujettis à la Finma doivent s’acquitter aujourd’hui d’une taxe annuelle inférieure à 1300 francs, le maximum étant de 15 500 francs.
William Türler
Bilan. 7 novembre 2012